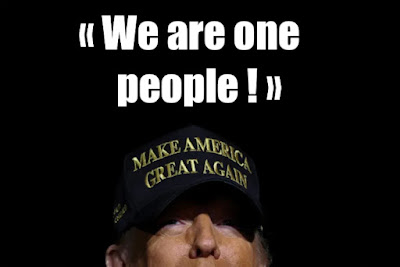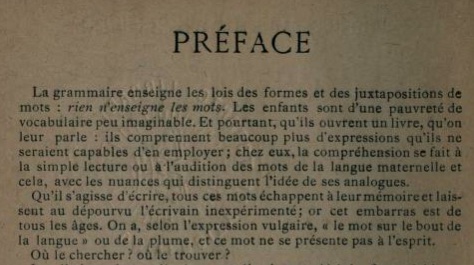vendredi 15 novembre 2024
Cultivons nos différences (ou : comment le Peuple finit toujours par se faire uniquer)
mardi 9 avril 2024
Comment des classes sont-elles possibles ? (8) Dialectique médiévale
vendredi 26 août 2022
Matière et individuation
≪Où la division du genre en espèces s'arrête-t-elle ? La doctrine d'Aristote telle qu'elle est en général comprise répond : à "l'espèce dernière", également dite "indivisible". Ici se pose l'un des plus redoutables problèmes interprétatifs de l'Aristotélisme. L'une des directions fortes de la pensée d'Aristote, en effet, tend, contre un certain Platonisme, à accorder la priorité ontologique aux individus concrets, ce qu'Aristote appelle "le ceci" (tode ti), plutôt qu'aux universaux. Deux interprétations s'opposent sur le principe de cette individuation. Ce qui fait d'une réalité individuelle ce qu'elle est ─ son essence exprimée dans sa définition ─ c'est sa forme. Certains interprètes considèrent que cette forme est partagée par tous les membres de l'espèce dernière. Le principe d'individuation, qui permettrait de passer de cette espèce dernière aux individus, serait donc la matière. La différence entre l'homme ─ espèce que l'on peut sans doute définir de manière plus fine : l'homme athénien, blanc, etc. ─ et Socrate est la différence de la matière propre de Socrate qui n'est pas celle de Coriscos. D'autres interprètes contestent que la matière puisse jouer ce rôle individualisant, parce qu'elle est précisément ce qui est indéterminé, et que pour aller vers un surcroît de détermination, il faut aller vers un "surcroît de forme". C'est peut-être pour cela qu'Aristote a inventé l'obscure formule to ti èn einai, que les médiévaux ont traduit par "quidditas", et qui, quel qu'en soit le sens exact, désigne une sorte d'essence de l'essence dans le sens d'une caractérisation essentielle d'un être individuel. Peut-être la solution de ce dilemme se trouve-t-elle dans le mécanisme lui-même de la connaissance humaine. À la fin des Seconds Analytiques (II, 19, 100a16), Aristote rappelle que "ce qui est l'objet du sentir, c'est l'individuel, mais la perception porte sur l'universel, par exemple l'homme et non Callias". Je perçois Callias comme porteur d'une forme, c'est-à-dire d'une structure signifiante. L'espèce dernière est ainsi perçue dans les individus eux-mêmes.≫
(Pierre Pellegrin, Dictionnaire Aristote)
samedi 11 juin 2022
Proximité du système philosophique, de la solitude et de la folie
mardi 11 janvier 2022
Misanthropie, Misologie et Dialectique
samedi 19 juin 2021
Comment des classes sont-elles possibles (7) ? Nietzsche vient foutre son dawa...
mercredi 28 avril 2021
Venons-en Ophite !
(G.-W.-F. Hegel)
***
«La Bible, rassemblée et rédigée plus tard par les prêtres de manière si orthodoxe, n'affirme aucunement que le fruit ait été une illusion. L'arbre s'appelle bien arbre de la connaissance, non de l'erreur ; aussi bien le serpent, qui d'après la Bible fut envoyé par le père du mensonge, n'a pas été trompeur dans sa promesse, car Yahvé lui-même dit ensuite : Voici qu'Adam est devenu comme l'un de nous, car il sait ce qui est bien et ce qui est mal (Genèse, 3, 22). Hegel insiste particulièrement sur ce verset, et cela dans les contextes les plus variés ; de cette vieille histoire, ce qu'il apprécie n'est en aucune manière l'interprétation purement et simplement négative, celle du péché originel. Avec l'exégèse commune de ce mythe étonnant il ne s'accorde que dans la mesure où il impute au serpent luciférien l'impudence, la chute, le défi, par conséquent ce qui est pour Hegel le mal moral (à un mal réel dans le monde l'optimiste spirituel ne consent pas). Mais en ce qui concerne la liberté comme humanisation, Hegel est du côté du serpent, non du côté de l'aveuglement, de la confortable innocence où le Yahvé biblique prétend maintenir les hommes (...) : "Le difficile est qu'il soit dit que Dieu a interdit aux hommes d'accéder à cette connaissance ; car la connaissance est justement ce qui constitue le caractère même de l'esprit ; l'esprit n'est esprit que par la conscience, et la plus haute conscience est justement dans cette connaissance-là."
(...)
La comparaison que fait Jésus en personne entre lui-même et le serpent sacré (Jean, 3, 14), les sectes l'ont très largement référée à leur propre sujet. Et à travers la théologie, jusque dans le relatif sauvetage chez Hegel des paroles du serpent, on retrouve une très ancienne trace, la trace de la secte des Ophites, dans l'Antiquité tardive. Les Ophites avaient tout d'abord inversé entièrement le mythe biblique du serpent, identifiant la tentation du Paradis à la tentation par Jésus ; le Christ est pour eux le retour du serpent ; le Christ donne son achèvement à l'Eritis sicut Deus [«Vous serez comme Dieu» : promesse du serpent à Ève, effectuée pour inciter celle-ci à consommer le fameux fruit, pendu à l'arbre de connaissance]. L'homme n'est plus un être asservi au créateur de ce monde mauvais ; une fois sauvé, il devient cet être libéré du monde dont ont parlé tant le serpent que Jésus, tant Jésus que le serpent. La trace, affaiblie, de ce parallèle inouï reparaît dans le pathos du sujet chez les baptistes, dans la pieuse hybris qui les jette au centre même de l'intimité divine de peur que Dieu ne soit pour eux comme un étranger ; le baptisme rejette toute réalité supérieure où l'homme ne serait pas présent. Et, totalement sécularisée, cette trace autonome se manifeste dans un événement qui souterrainement est encore en corrélation avec les mouvements hérétiques : la Révolution française. Cette hybris, par conséquent, que Hegel ne se lassa de définir comme la puissance qui a remis le monde sur la tête, c'est-à-dire sur la pensée. Passage de la servitude, sous toutes ses formes, fût-ce dans ses reflets transcendants, à la libération, au génie de la liberté. Du cri Sus aux tyrans, le jeune Hegel a presque tiré un nouveau calendrier des saints, orienté vers les tyrannicides athéniens Harmodius et Aristogiton, vers Brutus dont Beethoven gardait le buste devant les yeux. D'où cette phrase de serpent : "On enseigne à nos enfants le bénédicité, les grâces du matin et celles du soir. ― Ce n'est pas un Harmodius, un Aristogiton, ceux qui eurent l'éternelle gloire de frapper les tyrans et d'assurer à leurs concitoyens droits égaux et lois égales, ce ne sont pas eux qui ont vécu dans la bouche de notre peuple, dans ses chants" (Écrits théologiques de jeunesse). Partout se pressent là de tout autres hommages qu'à la béatitude de l'esclave, et ces hommages entretiennent avec le mythe du serpent une relation qui n'a pas échappé à Hegel».
(Ernst Bloch, Sujet-Objet, Éclaircissements sur Hegel)
mercredi 21 avril 2021
Conceptualiser l'expérience ?
« L’expérience intérieure ne trouvera nulle part, elle, un langage strictement approprié. Force lui sera bien de revenir au concept, en lui adjoignant tout au plus l’image. Mais alors il faudra qu’elle élargisse le concept, qu’elle l’assouplisse, et qu’elle annonce, par la frange colorée dont elle l’entourera, qu’il ne contient pas l’expérience tout entière. »
(Bergson)
***
L'intuition et l'intelligence divergent-elles à ce point ? Seraient-elles à ce point distinctes ? L'expérience ne serait-elle point, plutôt, du concept en puissance ? En sorte qu'on penserait déjà en ressentant, la pensée apparaissant, pointant, teintant déjà, de moins en moins loin, une sensation consistant tout entière dans son propre raffinement progressif : en idée. En sorte, ainsi, que la pensée (qui n'est que de juger, de classer, de ramener des expériences l'une à l'autre pour les comparer et les trouver, au moins potentiellement, commensurables d'une manière quelconque) procéderait de la sensation, et donc de la matière, comme de sa virtualité essentielle : d'une virtualité que la pensée développerait non comme on développe rétrospectivement, un possible déjà-tout-fait-tout-prêt et qui, d'une mystérieuse pichenette, passerait ainsi (déjà préformé) sans plus de difficultés à l'existence réelle, mais comme existent plutôt, diversement, des représentants différents d'une même réalité vivante et matérielle : plantes, animaux, idées. L'intelligence conceptuelle serait donc de l'intuition, de l'expérience individuelle, en simple voie de traduction, ou d'expression différenciée.
samedi 13 février 2021
samedi 30 janvier 2021
«Sputiamo su Hegel» (bis)
«Le féminisme, pour les femmes, prend la place de la psychanalyse pour les hommes. Dans cette dernière, l'homme trouve les raisons qui le rendent inattaquable (...). Dans le féminisme, la femme trouve la conscience féminine collective qui élabore les thèmes de sa libération. La catégorie de répression dans la psychanalyse équivaut au Maître-Esclave dans le marxisme [et l'hégélianisme] : les deux forment une utopie patriarcale où la femme est vue comme le dernier être humain réprimé et asservi pour soutenir l'effort grandiose du monde masculin qui brise les chaînes de la répression et de l'esclavage.»
(Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti, in Scritti di Rivolta Femminile, Milan,1978)
«Sputiamo su Hegel»
«Avec Ester, je ne peux que me taire. Elle est en colère contre elle-même et ne le supporte pas. Maintenant, elle ose dire ce qu'elle n'avait jamais encore exprimé, ce qui était encore impensable : que dans notre relation, je suis l'homme et elle est la femme. C'est ainsi que la dichotomie de la vaginale et de la clitoridienne fait retour, et même le féminisme ne pourra y mettre fin. »
vendredi 11 décembre 2020
En attendant que les troquets rouvrent
samedi 14 novembre 2020
Toute ressemblance, etc
mercredi 2 septembre 2020
De la contradiction
samedi 18 avril 2020
Des régimes de vérité (Lumières des positivistes)

jeudi 16 avril 2020
Des systèmes vivants, et des discours distincts devant leur correspondre (les schèmes de Jacob)

samedi 19 janvier 2019
jeudi 20 décembre 2018
L'effectif est rationnel (Marx hégélien)

« La pratique de la philosophie est elle-même théorique. C'est la critique, qui mesure l'existence individuelle à l'aune de l'essence, la réalité particulière à l'aune de l'Idée. »
(György Lukács, Le jeune Marx)
lundi 3 septembre 2018
Circuit de la récompense

vendredi 15 juin 2018
Au fil de l'eau