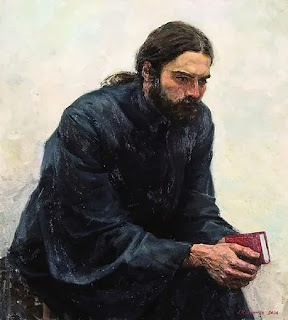«Ce livre ne pouvait pas attendre, il était trop urgent et nécessaire», me confie la philosophe américano-allemande Susan Neiman dans son hôtel à Gand. Actuellement en tournée à travers l'Europe pour lancer son dernier livre Left is Not Woke [La Gauche n’est pas le Wokisme], Neiman est née et a grandi à Atlanta, mais a passé la majeure partie de sa vie d'adulte en Allemagne, où elle est directrice du Forum Einstein à Potsdam. Elle a écrit plusieurs livres sur la responsabilité morale, sur l'éthique et les pensées des Lumières, et sur la façon dont l'Allemagne a tenté d'expier les atrocités nazies. Son œuvre la plus ambitieuse à ce jour, Evil in Modern Thought [Penser le mal] est une nouvelle histoire de la philosophie moderne vue comme une série de réponses au problème du mal moral. Elle préparait un autre tome philosophique, Heroism in an Age of Victimhood [De l’héroïsme à l’âge victimaire] mais la montée de l'idéologie «woke» l'a tellement inquiétée qu'elle a décidé de s’atteler à cet ouvrage de dimension plus réduite. «Mon éditeur s'est précipité sur le livre, qui sera également publié très rapidement dans d'autres langues». Neiman reconnaît n'avoir pas écrit le livre à l’intention de son milieu professionnel universitaire : «C'est l'une des raisons de mon engagement en faveur des penseurs des Lumières, qui n'écrivaient pas non plus pour leurs étudiants diplômés mais pour le grand public. Et ces Lumières – leur universalisme, leur foi dans le progrès et la justice – sont aujourd'hui attaquées par des intellectuels et des militants qui se prétendent, à tort, de «gauche». L’interview qui suit s’est déroulée au cours d’une balade effectuée le long des canaux médiévaux de Gand, jusqu'au site de l'ancien monastère où Susan Neiman s'apprêtait à donner sa conférence. Philosopher... En se promenant, après tout ! c'est bien ainsi que le père fondateur de la philosophie occidentale Aristote – célèbre mâle blanc mort parmi tant d'autres – l'avait initialement imaginé, non ?
***
Maarten Boudry : De nombreuses personnes de gauche pensent que le péril «woke» n'est au fond qu'une pure création imaginaire, un fantasme de droite. Pourquoi avez-vous pensé qu'il était nécessaire d'attaquer cette idéologie sous un angle explicitement de gauche ?
Susan Neiman : Au cours des deux dernières années, j'ai rencontré bon nombre d’amis, dans de nombreux pays différents, qui évoquaient – discrètement et uniquement entre amis de confiance – tel ou tel incident lié à des «excès de wokisme», la censure de telle ou telle personne pour des raisons ridicules. Et tous ces gens me confiaient, moroses : «Bon voilà, ça y est. Je suppose que je ne suis plus de gauche». Et à un certain moment, ma réaction s’est imposée : non, ce sont eux, toute cette foule de «wokistes» qui ne sont plus de gauche. J'ai donc voulu casser ce schéma binaire d’un simple affrontement entre gauche «woke» et droite, démêler toute cette confusion, pour faire en sorte que la gauche se réapproprie enfin certaines positions fondamentales, comme l'universalisme et la croyance au progrès moral. La version la plus courte de mon argument est que l’idéologie woke, bien qu'alimentée par toutes sortes d'émotions progressistes, telles que la sympathie envers l'opprimé, l'indignation exprimée par les marginalisés, aboutit en fin de compte à des idées extrêmement réactionnaires.
MB : Naturellement, vos détracteurs diront que vous apportez de l’eau au moulin de la droite.
SN : Je le comprends très bien, et j'étais très nerveuse, au début, à l'idée d'aider et de renforcer ainsi la droite. Critiquer le wokisme semble vous mettre, d’un seul coup, dans le camp des Ron De Santis, Donald Trump ou Rishi Sunak. Et bon nombre d’amis m’ont dit : «Susan, je suis entièrement d'accord avec ton point de vue, mais par pitié, change de titre ! Évite de te lancer dans toute cette mode du débat autour du woke». J'y ai pensé, bien entendu, mais je n'ai pas trouvé d'autre titre qui fonctionne. Nous savons tous de quoi nous parlons. Mais j’entendais préciser, dès la première page, qu'il s'agit d'une voix de gauche. Je suis de gauche, socialiste et je l'ai toujours été. J'ai également été assez prudente en évitant d’apparaître dans certaines émissions de droite où j'avais clairement prévenu mon éditeur que je ne mettrai pas les pieds.
MB : J'imagine qu'elles auraient bien jubilé de vous avoir, pourtant, sur le mode : «Voilà que même une philosophe de gauche s’aligne sur nos positions, maintenant !»...
SN : Je n'ai récolté qu'une seule critique émanant de la droite conservatrice, disant en substance : «Il faut d’abord se taper beaucoup de conneries de gauche pour y arriver, mais enfin, bon, elle finit par y arriver, ses arguments sont bons». Il est assez clair que je ne suis pas instrumentalisée par la droite. Mais concernant, à présent, tous ceux qui prétendent que le «phénomène woke» n'est pas un phénomène réel, je me demande juste s'ils n’auraient pas vécu au fond d’une grotte ces derniers temps. Il suffit, tout simplement, de jeter un œil à la liste de ce qui se publie et de ce qui ne se publie pas. Je parle là d’une situation mondiale, internationale. Les choses ont peut-être bien commencé dans les universités américaines, mais cela a désormais, par exemple, des conséquences évidentes sur la vie culturelle à Berlin, ville où je réside. Dans mon livre, je ne donne pas une très longue liste d'exemples, parce que je veux aller droit aux racines philosophiques de l'affaire, mais il suffit d’évoquer «l’affaire» emblématique de la critique de la traduction néerlandaise
du poème d'Amanda Gorman. Voilà un parfait exemple de la raison pour laquelle toute l'idéologie dite de «l'appropriation culturelle» est si extraordinairement problématique. Rappelons les faits : Gorman choisit un traducteur en se basant sur le fait que cette personne a écrit un travail qu'elle aime. Quelqu'un qui saura faire passer ses mots. Là-dessus, une blogueuse afro-néerlandaise ou surinamaise, spécialisée dans la mode, écrit que seule une femme de couleur pourrait traduire correctement le travail de Gorman, s’interroge sur le fait qu’on n'en ait pas trouvé. Et finalement, le traducteur d'origine, qui est blanc (et également «non-binaire», au passage...) s’efface, au profit d’un traducteur néerlandais noir. Puis la chose se reproduit dans toute l'Europe. La traduction espagnole, par exemple, est refaite par une personne de couleur, les Allemands trouvant, eux, une solution très allemande, avec un comité de traduction composé de trois personnes provenant d'horizons différents. L'idée que vous ne pouvez écrire sur tel ou tel sujet que si vous avez l'identité ethnique et de genre correspondant au sujet sape le pouvoir de la culture elle-même. C’est la thèse que l’un de mes amis, un non-blanc visible [Susan Neiman fait vraisemblablement référence ici à
Benjamin Zachariah], a défendue au cours de toute une série de conférences, sous le titre : «La culture, C’EST l'appropriation».
MB : Parce que rien n'y est entièrement original et que tout y est emprunté ?
SN : Ne considérons pas la culture comme une marchandise, mais comme une communication. Ce qui est fou avec l'identitarisme actuel, c'est qu'il nous réduit aux deux aspects de l'identité sur lesquels nous n'avons strictement aucun contrôle. Au lieu des idées que vous avez, des jugements que vous portez, des carrières professionnelles que vous construisez, des compétences que vous acquérez et des relations que vous établissez, vous êtes réduits aux deux éléments de l'identité sur lesquels vous avez le moins de contrôle et qui peuvent juste le mieux vous profiter en tant que victime.
MB : Parlons de l'attaque dirigée contre les «Lumières». Selon les idéologues woke, les Lumières constitueraient la racine de l'eurocentrisme, du colonialisme et du racisme.
SN : Quand j'ai entendu développer ces points de vue pour la première fois, au début de ce siècle, de la part de théoriciens postcoloniaux, j'ai pensé que c'était tout simplement trop idiot pour que l’on s'en soucie. Mais aujourd’hui, vous pouvez simplement lire sur la page Wikipédia consacré à Kant qu'il était raciste et colonialiste. Ce sont les Lumières qui ont inventé la critique de l'eurocentrisme. Il suffit d'ouvrir un livre, même pas un livre savant : quelque chose comme le très lisible et satirique roman Candide, de Voltaire, par exemple. Les penseurs des Lumières ont fermement condamné le colonialisme et le racisme. Quand les post-colonialistes soutiennent que nous devons prêter attention au reste du monde, et à la façon dont l'Europe apparaît aux yeux du reste du monde, cette idée-là, c’est le siècle des Lumières. Le fait que Kant et Voltaire ne soient pas allés aussi loin que nous le ferions aujourd'hui, par exemple dans la condamnation du racisme, doit être quelque chose dont on peut se réjouir, car cela montre que le progrès existe. Une chose qu'ils n'ont absolument pas comprise, en revanche, c'est le sexisme. Pourquoi ces gens, qui ont tant écrit sur l'universalité et les droits humains à travers les cultures, n'ont-ils pas accordé les mêmes droits aux femmes vivant juste à côté d'eux ? Ils ne l'ont pas fait. Il convient certes de rappeler que les femmes étaient contraintes de procréer, au 18ème siècle, d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Toute femme était tenue d’avoir cinq enfants, dans le but de remplacer une population humaine menacée par des taux de mortalité énormes touchant les enfants autant que les mères. Je ne voudrais pas laisser les philosophes des Lumières s'en tirer là-dessus, mais prenons, par exemple, le cas de l'amante de Voltaire, Madame du Châtelet, traductrice de Newton et auteure d’ouvrages sur l'astronomie, et qu’il respectait en tant que penseuse. Elle est morte en couches.
MB : Vous portez des jugements sévères sur Michel Foucault, le qualifiant d'au moins aussi réactionnaire qu'Edmund Burke ou Joseph de Maistre, deux figures incontournables des Anti-Lumières. Comment se fait-il alors qu'il soit considéré comme un parangon de la pensée progressiste ?
SN : J’aimerais vraiment pouvoir m’asseoir cinq minutes en compagnie de quelqu'un pensant que Foucault était progressiste et écouter l’un de ses arguments en ce sens (autre que le fait qu'il était ouvertement gay à une époque où c'était très inhabituel). Qu'il s'agisse d'écoles, de maisons de fous, de prisons ou d'autres institutions, Foucault a toujours soutenu que ce que vous considérez comme un progrès est, en fait, une forme beaucoup plus subtile de domination et de contrôle. Ainsi, chaque fois que vous essayez de faire un pas en avant, vous vous retrouvez malgré vous à faire quelque chose de plus dévastateur. La raison pour laquelle il est pire que de Maistre ou Burke, c'est qu'il a un discours beaucoup plus puissant.
MB : Plus insidieux.
SN : Oui. Absolument insidieux.
MB : Les défenseurs de Foucault vous répondraient que, contrairement aux vrais réactionnaires, il luttait contre l'oppression en dévoilant les mécanismes de celle-ci.
SN : Exact. Mais il vous donne aussi l'impression que quoi que vous fassiez pour combattre ces mécanismes d'oppression, ils sont plus grands que vous, et vous en faites même d’ailleurs partie. C'est un extraordinaire appel au défaitisme ou à la résignation. Prenons le cas des réformes pénitentiaires : où se situait-il au juste, là-dedans ? Quand les gens parlaient d'améliorations concrètes qui rendraient la vie des prisonniers meilleure, Foucault disait simplement : «Tout cela est bien trivial, bien insignifiant». Et beaucoup d'universitaires soi-disant progressistes en sont venus, à sa suite, à penser qu'il suffisait au fond de déconstruire les mécanismes du pouvoir. Mais la déconstruction n'est pas un acte politique en soi.
MB : Vos collègues universitaires rétorqueront sans doute que vous avez compris Foucault complètement de travers.
SN : Un de mes amis m'a dit que je n'étais pas juste envers Foucault, que toute son œuvre nourrissait en réalité la libération. Évidemment, je ne voulais pas commettre d'erreur aussi grossière, alors j'ai décidé de revenir en arrière et de donner une nouvelle chance à Foucault. J'ai lu sa dernière série de conférences sur le néolibéralisme, qui se révèlent assez perspicaces en termes de diagnostic, parce qu'il écrit en 1978-1979, alors que le néolibéralisme n'avait pas encore conquis la planète. Mais quel est l'impact normatif de sa discussion, en vérité ? J'ai fait l’acquisition de tout un volume d'essais rédigés par des érudits, spécialistes de Foucault, qui ne parviennent même pas à se mettre d’accord entre eux sur le fait de savoir s'il était, lui, pour ou contre le néolibéralisme. Désolé, mais maintenant, à vrai dire, je m'en fous complètement. Je ne pense pas que patauger dans ce genre de marais scolastique soit ce dont nous avons vraiment besoin en ce moment. Quand on parle des idéologues woke, on ne parle pas d'une armée d’experts ès Foucault-Schmitt-Heidegger. De nombreux wokistes n'ont peut-être même jamais entendu parler d’aucun de ces noms-là. Pourtant, certaines de leurs hypothèses réactionnaires se sont pour ainsi dire infiltrées partout, ont imprégné le courant général, à la source.
MB : À l'origine, les Lumières visaient aussi à détruire les vieilles certitudes, les dogmes, les traditions, la foi. Mais après que toutes les vieilles idoles eurent été brisées, que restait-il d'autre à détruire ? Eh bien, disent les post-modernes : les fondements même des Lumières elles-mêmes ! Rationalité, vérité, progrès. Peut-on considérer le postmodernisme lui-même comme un enfant des Lumières, un enfant capricieux et rebelle ?
SN : Je pense que vous avez raison et le même problème se pose avec Adorno et Horkheimer. J'ai récemment échangé avec un spécialiste de leur célèbre Dialectique de la Raison, et qui défend la thèse selon laquelle tout leur projet commun visait au fond à déconstruire les fondements des Lumières, afin de construire de «nouvelles Lumières», sur de meilleurs fondements. Et là, j'ai demandé : pouvez-vous me montrer où exactement Adorno et Horkheimer défendent un tel projet ? Et sa réponse a été : «Eh bien, en fait, ils n'ont jamais écrit la deuxième partie !» (rires).
MB : Essayons de suivre à la trace vos adversaires, d’adopter leurs perspectives, une fois encore. Certes, l'eurocentrisme n'a pas été «formellement» inventé par les Lumières. Mais n'est-il pas vrai, cependant, que les Occidentaux entendent imposer leurs valeurs et leurs normes au reste du monde ? Ne désirons-nous pas, par exemple, que le monde entier adopte la démocratie ? Un tel universalisme est tout à fait étranger, disons, à la civilisation chinoise. Aujourd'hui, la Chine est également accusée de colonialisme avec son initiative des «Nouvelles Routes de la Soie», mais une différence notable ne serait-elle pas qu'elle n'a aucunement l'intention d'imposer son propre système politique aux pays africains. Nous faisons cela, en revanche. Nous prétendons posséder certaines valeurs «universelles» dont nous pensons qu'elles ne sont pas négociables. Comment réagiriez-vous à ce type d’accusation ?
SN : Le problème est que vous pourriez faire la même affirmation relativiste à propos de coutumes et traditions «indigènes» qui sont encore pires [que les traditions occidentales] : pensons aux mutilations génitales féminines. Quelqu'un comme Narendra Modi, le président indien actuel, est un parfait exemple de l'utilisation abusive d'une telle rhétorique post-coloniale et des revendications sur l'indigénité. Oui, les droits de l'homme ont été formalisés à l'origine en tant que concept en Europe, bien que des versions en existent dans d'autres cultures. Mais malgré tous les méfaits très réels du colonialisme britannique en Asie du Sud, présenterons-nous comme une mauvaise chose le fait que le colonialisme en question ait attaqué puis interdit le «Suttee» (sacrifice volontaire traditionnel des veuves sur le bûcher de leur mari) ?
MB : Peut-être qu'au fond, même celles et ceux qui font semblant de brandir le relativisme culturel sont des universalistes cachés, parce que lorsqu'il s'agit d'exemples extrêmes comme les mutilations génitales féminines et le Suttee, ils ou elles reculent ?
SN : C'est tout à fait ça. Il suffit de descendre de l'abstrait aux cas particuliers pour trouver, d’un seul coup, bien plus d'accord universel !
MB : En parlant d'universalisme, vous reliez le tribalisme de gauche d'aujourd'hui à la montée de la psychologie évolutionniste. Mais cela me semble étrange. L'une des pierres angulaires de la psychologie évolutionniste est en effet la notion d'universalisme et de nature humaine «partagée» en dépit de toutes nos différences culturelles. Si vous comparez l'esprit d'un chasseur-cueilleur d'il y a deux millions d'années avec l'esprit d'un être humain moderne, ce serait presque exactement la même chose, car l'évolution est trop lente et les différences génétiques entre les populations humaines apparaissent trop superficielles pour qu’il en soit autrement. Il me semble donc non seulement que la psychologie évolutionniste n'offre pas exactement un terrain fertile pour le tribalisme, et peut-être même, au contraire, qu'elle pourrait constituer un rempart contre cette croyance en l’existence de barrières ethniques et culturelles infranchissables.
SN : Je vois bien le type d’usage possible auquel vous vous référez. Mais permettez-moi, d’abord, de poser la question suivante. Quand vous dites : «Prenez l'esprit d'un chasseur-cueilleur d’il y a deux millions d'années», comment, au juste, l’avez-vous «pris», cet esprit ? Et comment qui ce soit d'autre pourrait bien, à son tour, «mettre la main dessus» ? Je dois admettre que c'était là la partie de mon livre dont j'étais le moins assurée et satisfaite, alors je m’en suis ouvert à mon ami Philip Kitcher, qui a commis au moins deux ouvrages sur la psychologie évolutionniste. Je l’ai prié de lire les passages en question et de me dire franchement où j’avais pu faire fausse route. Il s’est fendu de quelques suggestions mineures, mais son avis était néanmoins que j'avais bien compris le cœur de la chose. La psychologie évolutionniste est le plus grand exemple d'une pseudo-science ayant atteint la respectabilité maximale. En l’absence, pourtant, de tout fondement susceptible d’étayer ses recherches et de les prolonger. Certes, l'évolution fonctionne lentement, d’accord ! Mais nous ne bénéficions pas pour autant d’un «accès libre» à l'esprit des chasseur-cueilleurs. Nous pouvons scruter leurs ossements, étudier diverses reliques archéologiques, mais parler de leur «esprit» relève de la pure imagination. Même si nous savions ce que pensaient nos ancêtres il y a deux millions d'années, nous n'aurions absolument aucune raison de croire que nous avons les mêmes pulsions et motivations qu'eux, car au cours des deux millions d'années qui ont suivi, les cultures ont également évolué.
MB : Vous ne croyez donc pas à l'existence d'«universaux humains» (comme
dans la liste de Donald Brown) censés montrer que de nombreuses cultures, évoluant indépendamment les unes des autres, ont cependant des choses en commun, telles que les intuitions morales, les émotions, les capacités cognitives ? L'explication la plus simple de cela ne serait-elle pas que nous possédons au moins quelques dispositions innées ?
SN : Je pense que nous possédons, certes, beaucoup de dispositions innées. Mais l'essentiel des principes de la psychologie évolutionniste de pointe se résume à cette seule disposition qui serait la nôtre, à savoir : la volonté de développer, sans relâche, notre propre patrimoine génétique, et à l'idée que ce serait là la base de la moindre de nos actions. De ce point de vue, les psychologues évolutionnistes posent ce qu'ils appellent le «problème de l'altruisme». Assez significatif, en vérité, qu’ils considèrent cela comme un problème ! En fait, l'altruisme est assez courant dans le monde vivant, comme vous pouvez le lire dans les livres de Frans de Waal. Et pour expliquer l'altruisme, ils disent des choses comme : vous sacrifierez vos propres intérêts si et seulement si vous augmentez le patrimoine génétique de vos proches, au profit soit de deux enfants, soit de quatre nièces ou neveux, etc. Tout cela a un côté presque comique, parodique. Ce n'est pas une coïncidence si la psychologie évolutionniste a été réinventée, et reconditionnée, à l'époque où tout le monde a commencé à répéter l'affirmation de Margaret Thatcher selon laquelle «il n'y a pas d'alternative» au néolibéralisme mondial. Les gens ont spéculé sur la nature humaine pendant des milliers d'années mais, comme l'a souligné Rousseau, nous projetons toujours nos propres idées préconçues sur la nature humaine. Seulement voilà : tout d’un coup, quelque chose débarque, qui s'appelle «la science» et si vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous êtes forcément rangé dans le camp de l'un ou l’autre de ces créationnistes dérangés…
MB : Mais supposons que vous ayez raison de dire que la psychologie évolutionniste est une pseudo-science. Pourtant, les plus grands adversaires de la psychologie évolutionniste sont les wokistes. Eux détestent absolument ça.
SN : Une attaque woke contre la psychologie évolutionniste ? Ah bon ! Il faudrait me la montrer. Parce que je ne l’ai encore jamais rencontrée.
MB : Eh bien, cette psychologie est présentée comme sexiste, car essentialisant les différences entre hommes et femmes.
SN : Ma foi, c'est le cas ! Mais cela, même nos chers wokistes l’assument. Vous ne pouvez pas grandir dans un tel milieu sans absorber ce genre de discours. Une fois, j'ai parlé de psychologie évolutionniste avec mon fils, qui est un réalisateur de documentaires et un penseur très «woke», quoique sophistiqué. Et il m'a juste dit : «Eh bien, ce n'est que de la science !»
MB : Que diriez-vous d'une autre source intellectuelle prêtée au wokisme, à savoir le marxisme ? Certains ont soutenu que le wokisme est fondamentalement l'application des schémas de pensée marxistes dans la sphère non-économique, donc à la sexualité, au genre, à l'ethnicité. Vous divisez la société en deux groupes, les oppresseurs et les victimes, on se retrouve avec un jeu à somme nulle, avec un no man's land au milieu. Les deux groupes ont leur propre conscience collective, mais la classe des victimes est épistémiquement privilégiée en raison de sa victimisation. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous souffrez de «fausse conscience».
SN : C'est là une vision bien réductrice du marxisme, même si je dois dire ici que je suis socialiste, pas marxiste, pour plusieurs raisons, mais principalement parce que Marx était un réductionniste de classe, du moins dans ses écrits tardifs. Au 19ème siècle, cela avait un sens de l’être, mais ce serait une façon ridicule de diviser les gens au 21ème siècle. Les gens ne font pas seulement les choses en fonction de leur intérêt de classe, et c'est un euphémisme. Marx s’est ainsi trompé de deux côtés : d’abord de celui des millions de gens de la classe moyenne ayant un jour soutenu le socialisme, non pas à cause de leur intérêt de classe mais à cause d'un sens de la justice ; et, de l’autre, de celui des millions de gens de la classe ouvrière qui ont continué, vaille que vaille, à défendre des intérêts réactionnaires.
MB : De la même manière, les personnes non-blanches ne suivant pas la ligne du parti, comme Ayaan Hirsi Ali ou John McWhorter, sont rejetées comme des «traîtres à la race» ou des «oncles Tom».
SN : Ce genre de pensée est très en vogue. Un de mes amis, éminent historien indien (et à ce dernier titre représentant pourtant évidemment bien identifié d’une «minorité visible») travaille sur les racines fascistes du post-colonialisme. Et bien, il s’est vu débarqué, tout simplement, par de nombreuses institutions ! Ça, c'est vraiment un problème. Si vous voulez représenter un groupe particulier, les seules voix considérées comme «authentiques» au sein de celui-ci seront celles qui insistent sur la victimisation maximale. J'ai moi-même été traitée d'antisémite par un certain nombre de journaux allemands, et de «traître à ma race» par certains juifs conservateurs, parce que je défends cette idée étrange selon laquelle les Palestiniens méritent les mêmes droits que les Israéliens et du fait que je ne considère pas le fait d’être juif comme un motif fondamental d’auto-victimisation. Bien sûr, tout wokiste sera par principe pro-palestiniens à ce stade de l'histoire, les Palestiniens constituant un groupe victime évident. Mais je soutiens, moi, les droits civiques des Palestiniens du fait que je suis universaliste, pas parce que je me rangerais de manière automatique et immédiate du côté des gens de couleur.
MB : Êtes-vous d'accord pour dire que la montée de la droite dure («l'alt-right») est en partie motivée par le wokisme ? Les deux factions ne se rendent-elles pas mutuellement folles ?
SN : Il y a du vrai là-dedans. J'ai rencontré des gens tellement rebutés par les idées woke qu'ils disent évoluer vers le centre ou le centre-droit. Mais ce qui reste plus courant, c'est que les gens qui se situeraient à gauche se retirent purement et simplement de tout engagement politique, parce qu'ils ont le sentiment que la gauche a été capturée, confisquée. Je termine le livre en rappelant aux gens comment les fascistes sont arrivés au pouvoir en 1933 : si les gauchistes avaient formé un front uni contre le fascisme, le monde aurait été épargné d'une terrible guerre. Le problème est que la gauche dévore toujours ses propres enfants et passe à côté du vrai danger. Donald Trump pourrait vraiment redevenir président. Le Pen pourrait battre Macron si des élections avaient lieu aujourd'hui. Le président du plus grand pays du monde est un fasciste, selon mes amis indiens. Les dangers de notre époque sont bien réels et nous devons renforcer nos propres rangs».
Traduction française : Le Moine Bleu